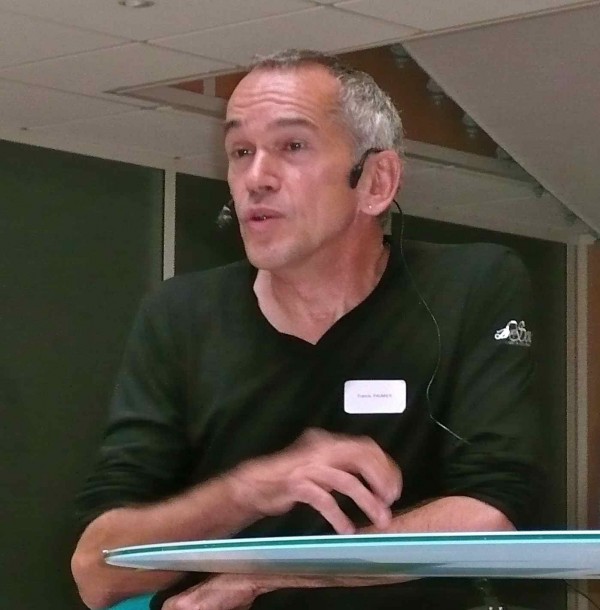Communication à la huitième journée de Rencontre de Paradoxes, 10 octobre 2009
Francis Paumier, psychiatre
Le statut de psychiatre est parfois difficilement conciliable avec la vision non normative du modèle de Palo Alto. Certains patients attendent de se trouver face à un médecin en position haute et sont en demande de médicaments. En cherchant à les convaincre d’accepter une autre voie, on peut se retrouver, paradoxalement, dans une position encore plus haute.
La position basse, si elle n’est qu’une technique et non le résultat d’un travail sur soi, risque d’être vite mise à mal par la « contrainte » du résultat. Ne faudrait-il pas alors préférer, à la position basse, une position de non-savoir qui ne relève pas de l’apprentissage mais d’une réflexion sur nos buts conscients, nos motivations, nos intérêts ?
—————–
Lorsque j’étais interne, j’ai eu la chance d’exercer dans un hôpital de jour. Je me suis battu pour avoir ce poste qui n’existait pas auparavant. L’expérience menée était très séduisante, avec une volonté déterminée de l’équipe infirmière de réduire l’écart de position soignants-soignés, et de promouvoir une atmosphère démocratique et un soin inspiré des grandes idées de la psychothérapie institutionnelle, émanation partielle de l’antipsychiatrie. Mais si la théorie était très séduisante, elle était maniée d’une main de maître par un infirmier gourou, détenteur de la vérité pour les soignants et les soignés. L’histoire a mal tourné, mais je me souviens surtout avoir eu pour la première fois le sentiment de devenir fou, pris d’angoisses, de mouvements d’ambivalence extrêmes, de sentiments contradictoires. Sans rentrer dans les détails, je crois avoir rencontré les effets de la double-contrainte.
J’ai choisi de citer cette anecdote de mon parcours de formation pour introduire mon propos: « comment échouer à rejoindre la position basse en voulant être antipsychiatre ».
Cette communication va m’amener à tenter de mettre en sens des échecs répétés au fil des années dans mes tentatives d’application du modèle de Palo Alto. Elle est le fruit de réflexions internes sur la position et l’utilité du rôle de thérapeute, sur la position sociale de celui-ci.
Je me suis formé à ce modèle, le pratique, il reflète ma vison constructiviste de la réalité psychique, mais je continue à rencontrer des écueils basiques pourtant rabâchés, quant à la mise en œuvre de l’intervention, qu’il s’agisse de la définition du problème, de la position du thérapeute, du respect de la position du client, et de la stratégie paradoxale.
J’aborderai ici les éléments particuliers à la position de psychiatre en thérapie brève, et mon problème particulier avec cette position.
J’aborderai la question de la position basse dans la prescription de traitements psychotropes, et essaierai de décrire en quoi les loyautés inhérentes au mandat collectif attribué au psychiatre peuvent compliquer ma position de thérapeute. Parfois mes croyances, convictions, positionnements personnels peuvent m’amener à me fourvoyer.
J’ai choisi deux exemples cliniques, l’un pour illustrer une errance dans la thérapie, en oubliant certaines prémisses du modèle et en poursuivant des buts conscients ; l’autre montrant comment la thérapie se déploie en restant dans cette position basse ou en y revenant.
Je conclurai par l’extension de la notion de position basse à la position de non-savoir à atteindre. Celle-ci met en jeu à mon sens des questionnements quant aux visées non pas de la thérapie, mais du thérapeute. Je prends sans doute le risque de l’introspection mais ne prétends pas que l’on doive se poser ces questions-là nécessairement.
Avant d’aborder les cas de Paul et Odile, voici quelques remarques à propos de mon parcours et réflexions sur la position de psychiatre.
Ma vision du monde a été influencée par les idées portées par l’antipsychiatrie, cohérente avec mes idéaux politico-sociétaux. Le mouvement antipsychiatrique des années 60 visait à promouvoir un soin dégagé des volontés aliénantes de la société relayées par la psychiatrie.
Ce courant posait la question du normal et du pathologique et soutenait que la psychiatrie n’est pas une institution médicale mais politique. Sa mission serait de résoudre les problèmes posés à la collectivité par les comportements déviants, et non de résoudre les maux des patients.
Toutefois si à cette époque il existait un discours et un débat politique prenant en compte ces points de vue philosophiques, aujourd’hui, ces débats n’existent plus, et la remédicalisation du soin psychiatrique est la norme depuis une vingtaine d’années.
Les constats et réflexions qui m’ont amené à faire cette présentation aujourd’hui ne sont nullement pessimistes, puisque en utilisant le modèle de Palo Alto je passe d’une vision contrainte de l’exercice de la psychiatrie à la prise en compte de la contrainte comme stimulant de la créativité dans la relation au patient, au service des ressources créatives du patient.
En effet aujourd’hui il me semble que le modèle de Palo Alto se place au service, non plus d’une contestation des contraintes de la société, mais des ressources des patients au sein des systèmes avec lesquels ils interagissent.
Après un bout de chemin avec la psychanalyse, j’ai rencontré l’Institut Gregory Bateson et le champ nouveau des thérapies brèves. Ce fut dur pour moi, il faut un certain temps pour modifier ses schémas de pensée.
Le modèle m’a séduit par sa cohérence avec une éthique non-normative, non-aliénante. Le constructivisme, le travail en position basse et la visée brève de la thérapie rejoignaient des questionnements personnels quant à « la » thérapie:
– Le constructivisme qui conteste la notion d’une vérité et donc d’un savoir tout-puissant et normatif.
– La position basse comme position de travail nécessaire au respect de la vision du monde et des valeurs du patient.
– La brièveté recherchée pour obtenir un changement désiré par le patient sans passer par le transfert au thérapeute mais en opérant des changements d’ordre systémique.
Après quelques années de formation et de pratique dans mon cabinet, je me suis rendu compte que ce n’était pas si simple. J’ai d’abord pensé que je n’étais pas très doué, ou bien pas assez convaincu, ou bien que ça ne marchait pas pour les pathologies lourdes.
Ne fallait-il pas en fin de compte en passer quand même par l’inconscient?
La vision systémique n’est-elle pas réductrice?
Et puis, je me suis rendu compte que des gens travaillaient à aider des patients à résoudre de « vrais » problèmes. Des problèmes structurés, comme on dit en psychiatrie: phobies graves, anorexies, troubles obsessionnels compulsifs (TOC), dépressions. J’ai pensé alors que c’était réservé à des pointures. Je me suis parfois perdu.
Et puis je suis quand même psychiatre !
Or le psychiatre peut opter pour une pratique psychothérapeutique de son choix, mais il est confronté d’une part à une position définie par sa mission de médecin spécialiste (le mandat social officiel, politique), et par la possibilité de prescrire des traitements psychotropes.
Comment prescrire des traitements, et rester en position basse?
La société me confère un savoir scientifique et un statut. Beaucoup de patients nous interpellent sur ce mode.
Je suis sensé savoir de quoi je parle, en terme de traitements notamment. Or je suis traversé par certaines croyances.
– Croyance sur la priorité: j’ai souvent cru que ça ne servait que lorsqu’on ne pouvait faire autrement.
– Croyance sur l’efficacité: j’ai aussi pensé que les traitements médicamenteux étaient de nature à créer un leurre d’amélioration ou qu’ils pouvaient confusionner l’évaluation des résultats de l’intervention psychothérapique.
Qu’en est-il de la part du traitement et de la part de l’arrêt des tentatives de solution dans l’amélioration?
– Croyances idéologiques: le médicament ne serait-il pas un outil d’aliénation au service d’une normation de l’individu qui dysfonctionne socialement?
C’est plus avec les patients dépressifs ou bipolaires que j’ai été confronté à ces prises de tête.
« Le bipolaire » est le client parfait du psychiatre. La bipolarité est un trouble de l’humeur supposé depuis longtemps lié à une cause organique ou génétique. Le seul traitement proposé est en général le thymorégulateur à vie!
Par ailleurs on sait que les diagnostics sont plus ou moins établis par les laboratoires pharmaceutiques en fonction des leurs études scientifiques mais aussi du marché.
Nombre de patients bipolaires arrivent maintenant avec leur diagnostic « le docteur machin m’a dit que j’étais sans doute bipolaire, et puis il y a eu une émission à la télé..; etc. ».
Qu’en pensez-vous docteur?
Dois-je prendre un traitement à vie? Et puis on m’a dit que vous étiez spécialisé dans les troubles bipolaires !!!
En effet un jour j’ai répondu à une interview téléphonique pour une revue scientifique sur la dépression dont il est ressorti 3 lignes.
Je me suis aussi laissé aller à un coup d’humeur sur un forum internet pour contester la toute-puissance des informations pathologisantes dans les médias et la presse médicale.
Au final je suis apparu comme un spécialiste des troubles bipolaires, ce que je ne suis pas.
Cette situation type m’a placé à plusieurs reprises dans une position paradoxale:
Avec le modèle de Palo Alto je cherche à établir une relation avec le patient autour de son problème et à l’aider à arrêter ses tentatives de solution.
Par ailleurs je suis mandaté socialement pour le voir comme bipolaire
Enfin, le patient m’interpelle dans ma prétendue différence non conformiste en me plaçant de fait en position haute.
Cela n’est pas original en soi, ni particulier au psychiatre et tout l’art du thérapeute va être de rester en position basse malgré ce mandat premier du client.
C’est ainsi, en entretenant un point de vue critique ou idéologique sur la chimiothérapie, que j’ai pu me trouver quelques fois paralysé par mon « vouloir ».
– Vouloir aider le patient, je n’ai pas de doute à ce sujet.
Mais aussi vouloir lui prouver qu’il peut échapper à la description aliénante du statut de malade.
A partir de là je veux alors sauver le patient non seulement de sa souffrance, mais aussi du monde. Rassurez-vous ! Ce n’est pas une volonté consciente, puisqu’en faisant tout cela je suis convaincu d’être un bon petit soldat de la position basse !
Pris dans ce processus je ne suis pas fier de moi comme psychothérapeute, et en échec dans mes visées antipsychiatriques.
À ce moment, ou je redescends de cheval en position basse! (cf. le cas de Odile), ou j’essaie de sauver et défendre mes convictions et je m’enfonce ! Une autre solution est de devenir parano!
Bien sûr il faut bien avouer que certains patients suscitent plus d’affection, d’empathie, et excitent d’autant plus cette instance de sauveteur chez le thérapeute pris dans ce type de vouloir.
Les conséquences techniques et pratiques de cet écueil sont:
– Perdre malgré soi la position basse que l’on cherche à maintenir
– Entrer dans des tentatives de solution personnelles pour sortir de cette impasse par exemple en partant dans des explications infinies sur le sens des tâches demandées, jamais comprises.
– Proposer au patient une expérience pour qu’il vérifie mon explication, au lieu d’une expérience émotionnelle corrective dans son système de relation….
Comment réussir à échouer? Titre d’un ouvrage de Paul Watzlawick; voici donc une manière parmi d’autres d’échouer.
J’en viens à la description des cas de Paul et d’Odile.
Paul
Paul est venu me voir alors qu’il était diagnostiqué bipolaire.
En effet il avait fait quelques épisodes maniaques de forte intensité, qui l’ont conduit à être hospitalisé en psychiatrie.
C’est un garçon jeune très vif d’esprit, intelligent et fêtard. Il a terminé des études en marketing, et est bien formaté par ce cursus.
Il mène une vie d’éternel étudiant consommant beaucoup d’alcool dans les soirées qu’il affectionne, dans les bars ou les fêtes, et fumant du cannabis assez quotidiennement.
L’entourage médical et familial l’a briefé suffisamment pour qu’il comprenne qu’il est atteint d’une maladie. Il doit prendre un traitement, mais il le prend à sa façon, c’est-à-dire ou insuffisamment, ou pas. Il a arrêté par ailleurs une psychothérapie analytique qui n’avançait pas.
Moi, depuis peu de temps thérapeute palo altien et par ailleurs psychiatre, assez séduit par ce jeune homme très sympa, curieux et polémiste, je suis pris entre d’un côté une adresse de type psychiatrique: Suis-je malade? Dois-je prendre un traitement? et d’un autre côté ma position de psychothérapeute, si possible bref! que je privilégie.
Il me paraît impensable que ce jeune homme plein de ressources, professionnelles, relationnelles et humaines, soit ainsi enfermé dans un processus dont on lui dit qu’il devra faire avec toute sa vie, avec traitement etc.
Il en était même arrivé à renoncer, me demandant une allocation adulte handicapé, demande à laquelle je n’ai pas répondu.
Paul tient un discours anxieux de malade. Ses tentatives de solution l’amènent à évaluer en permanence ses cycles d’humeur, il anticipe le prochain cycle.
Il en arrive à prévoir lorsqu’il entreprend quelque chose, dans quel état il sera dans quelques mois.
Il peut par exemple différer sa recherche de travail de peur de ne pas être à la hauteur s’il passe en dépression.
Une autre tentative de solution vise à masquer cette maladie.
Il est convaincu qu’on ne lui permettra pas de travailler si on découvre qu’il n’a pas la pêche, ou qu’il est hors contrôle, ou encore qu’il est atteint de cette maladie.
Toutefois il ne peut renoncer à la vraie vie, sortir, s’amuser, faire le fanfaron, être la star d’une soirée, rencontrer des gens – tous intéressants – boire, et peu dormir.
Il adore cet état d’hypomanie mais commence à prendre des sédatifs pour tenter de contrôler le mouvement mais parfois en vain.
Lorsqu’il n’est pas en phase maniaque. Il ne supporte pas de se sentir mou, d’avoir envie de rester chez lui, de ne pas se mobiliser pour chercher du travail, de ne pas avoir d’excitation…
Il se considère alors dépressif ou est convaincu dès les premiers signes qu’il s’enfonce dans la dépression inéluctablement.
Il veut alors des antidépresseurs.
Ainsi Paul continue-t-il à gérer son problème en alternant un coup de rame à droite et un coup de rame à gauche.
Un coup d’antidépresseur quand la tempête dépressive s’annonce, un coup de sédatif quand l’excitation pointe son nez, etc.
Or extérieurement Paul apparaît cliniquement plutôt dans l’état moyen, « normal » de beaucoup de gens.
De mon côté je ne sais faire la part entre un vécu dépressif et l’angoisse qu’il a de le devenir, ce qui l’amène en cherchant à lutter contre, à le devenir, et je commence à postuler des hypothèses fonctionnelles.
J’établis des constructions sur le fonctionnement du problème, entendables mais surtout au service de ma contestation d’une fatalité bipolaire endogène.
J’essaie de le décourager de prendre des antidépresseurs qui souvent l’amènent à faire un virage vers la manie.
Je l’engage au contraire à travailler contre la peur de chuter.
Je recadre ces périodes comme des moments de rééquilibrage de ses énergies, de recentrage sur lui-même pour faire place à cette autre partie de lui plus adulte, plus professionnelle, etc.
Mais en vain. Il est convaincu qu’il va s’enfoncer inéluctablement dans la dépression, processus logique de la maladie.
Il utilise alors des stratégies subtiles, de la plainte à des manipulations habiles pour tenter de me faire fléchir, souvent avec humour!
Il me pousse dans mes retranchements en position haute. Je m’arque boute sur mes positions.
Et il obtient finalement la prescription, après que je me sois perdu dans des explications interminables et parfois virulentes de ma position.
Finalement, au lieu d’accepter de m’être trompé et de lui prescrire ses antidépresseurs, je les lui prescris par dépit qu’il ne veuille pas comprendre.
Je me rends compte qu’avec Paul je n’ai pas pris le temps de définir pour quel problème et pour quel objectif il souhaitait que je l’aide. Très vite j’ai fait de sa bipolarité le problème. C’est quand même aussi le sien, c’est là-dessus qu’il est polarisé. Mais, trop passionné par mon but conscient, mes croyances, j’en suis arrivé à lui tenir un discours aussi infantilisant que sa famille ou les médecins.
Certes Paul entend intellectuellement ma logique sur le sens fonctionnel de ses rechutes, mais il n’a pas de solutions, il obtient seulement des explications.
Je lui demande en fait de faire des efforts insurmontables.
Je bute certainement pour une part sur la difficulté que me pose ce patient d’un point de vue technique et stratégique. Mais je suis pris dès le départ dans un postulat en position haute.
Interviennent dans cette dérive vers une position haute:
– Ma conviction que les médicaments concourent à entretenir les cycles.
– Mes convictions idéologiques contestant l’aliénation à un diagnostic.
– Mes intérêts narcissiques à vouloir les prouver au client, en défiant le discours ambiant,… qui m’amènent à oublier le cadre et le modèle.
Le problème devient le mien et je ne peux faire autrement que passer en position haute.
Le paradoxe est qu’à vouloir poursuivre ces buts conscients, je réussis presque ce que je reproche à la psychiatrie, mais à l’envers, avec un point de vue antipsychiatrique. Et Paul peut m’amener chaque jour la preuve qu’il est bien l’objet d’une maladie qui agit à son insu.
Vis-à-vis de mes buts conscients j’ai tout faux, même si la relation de confiance qu’il a avec moi l’amène quand même à entretenir l’idée qu’il peut gagner en contrôle.
Mais d’un point de vue psychothérapique au sens de Palo Alto, il reste dans des changements de type 1 au mieux, mais vis-à-vis de quel objectif?
J’en resterai là pour l’évocation de ce cas. Je dirai juste que Paul a interrompu la relation pendant 5 mois, au cours desquels il a été voir un psychiatre prescripteur orthodoxe avec lequel il s’est fâché (pas d’écoute, position très haute, culpabilisation directe…).
La solution ne passait-elle pas parlà ? À savoir laisser Paul faire son expérience et confronter deux discours?
Odile
Odile est comme on dit une vieille routière de la psychiatrie et mes prétentions à la sauver sont plus mesurées. Je pressens plutôt de devoir reprendre un suivi hospitalier psychiatrique avec ajustement de traitements au fil des ans.
Odile est elle aussi bipolaire, et elle fait des épisodes gravement maniaques et dépressifs.
Petite bonne femme, au contact très attachant, elle fait preuve d’une grande intelligence, d’humour et d’une grande finesse d’esprit. Bien que rodée aux psychiatres, elle persiste à résister gentiment au discours général qui lui a toujours été tenu.
Peu avant de venir me voir, elle était suivie par une psychiatre hospitalière qui lui prescrivait son traitement. Elle se sentait frustrée du peu d’échange qu’elle avait avec ce médecin.
Elle dit souffrir d’un vécu dépressif et a peur.
Elle est angoissée par des idées noires qui la surprennent notamment le matin au réveil, et dont elle n’arrive pas à se défaire par ses tentatives de solution classiques, (se relaxer, essayer de penser à autre chose, positiver sur sa vie). Elle ne pense qu’aux drames ou malheurs pouvant arriver à ses proches, sa famille, voire au monde, ainsi qu’à des réminiscences du passé (suicide de sa mère, ses épisodes maniaques, son échec conjugal, etc.).
Son objectif c’est être débarrassée de ces angoisses insupportables, incontrôlables, éventuellement comprendre.
Elle est d’abord très étonnée lorsque je lui dis : « avec tout ce que vous avez vécu, et vu l’état du monde, vous avez de bonnes raisons d’avoir des idées noires ».
Je lui fais part de mon étonnement quant aux forces avec lesquelles elle a pu réussir à affronter tout cela.
Mais elle me demande aussi de reprendre son suivi médicamenteux (un antipsychotique, un antidépresseur, un anxiolytique). J’accepte cette demande.
Et je lui demande pour l’instant de ne rien changer dans son traitement, « dans son état actuel, il serait trop dangereux de prendre le risque de déstabiliser son équilibre précaire davantage » lui dis-je.
Elle effectue très scrupuleusement et avec enthousiasme les tâches d’observation et d’écriture de ses pensées négatives que je lui prescris, et se sent assez vite mieux. Quelques exceptions positives dans son vécu d’angoisse se révèlent, mais les angoisses matinales persistent. Par contre les journées sont moins pénibles.
Nous pouvons alors recentrer le travail sur des objectifs plus précis, concernant ses angoisses. Ses tentatives de solution visent en fait à éviter de se confronter à ses peurs. Elle vit alors du matin au soir à espérer que n’arrive pas un malheur, elle évite de regarder par exemple les informations de crainte de tomber sur de mauvaises nouvelles.
Je l’incite à visualiser le pire des situations alimentant ses peurs, plutôt que de les éviter. Mais elle est prise de panique à l’idée de faire cela.
Peu à peu, elle réussit néanmoins à faire diverses expériences. Elle essaie d’affronter davantage ses peurs, notamment de regarder le journal télévisé. Les exceptions augmentent, elle se surprend à refaire des choses auxquelles elle avait renoncé, par exemple se faire plaisir en faisant les magasins, en s’achetant des petites choses qu’elle se refusait, etc.
Mais les angoisses matinales persistent.
J’ai tendance alors à insister pour qu’elle étende l’application des tâches, mais sans succès.
Je peux alors cette fois revenir à une position basse en déclarant: « Ce que je vous ai proposé n’était peut-être pas une bonne idée, ces angoisses ont sans doute une fonction utile », ou encore « une explication m’échappe ».
Mais, première grande surprise, lors de la séance suivante elle me demande si elle ne devrait pas arrêter ses antidépresseurs, parce qu’elle ressent plus d’angoisse depuis qu’elle les prend.
Je lui dis alors en position basse, en freinant: « Je conviens que vous n’allez pas mieux en les prenant, mais il y a quand même un risque à les arrêter alors que vous vous sentez encore souvent déprimée chez vous ».
Elle décide d’arrêter ses antidépresseurs, et se sent mieux, en tout cas elle n’est pas plus dépressive.
Elle continue à écrire ses pensées négatives, à faire la tâche pour les infos. Puis un jour elle entreprend de changer son intérieur, de s’offrir un beau canapé, alors qu’elle pensait qu’elle n’en avait pas le droit.
A tel point qu’en bon psychiatre je commence à m’inquiéter, « ne fait-elle pas une rechute maniaque?! ». Mais son euphorie ressemble plus à une satisfaction de s’être fait un beau cadeau, qu’à une fuite en avant.
>Peu après, elle m’appelle en détresse, elle a très peur de faire une bêtise, de succomber à une pulsion suicidaire, elle veut reprendre un traitement antidépresseur pour être soulagée.
Je lui demande alors de me décrire en détail ce qu’elle veut faire, et comment elle ferait pour se suicider. Mais rien que d’y penser et de l’évoquer elle est terrorisée. Je lui fais part de ma compréhension: « il me paraît normal que vous pensiez à cela après tout ce que vous avez vécu et face à l’incertitude de votre avenir affectif et matériel. »
Est-elle certaine d’avoir encore des ressources pour faire face à d’autres aléas de la vie, malgré son réel intérêt à la vie, intellectuellement, et pour les autres.
Mais mon rôle, lui dis-je, n’est pas d’aider les gens à mourir. Je me montre désolé par ailleurs que cette thérapie ne lui apporte manifestement pas de soulagement.
Donc je suis d’accord, il est vraiment judicieux qu’elle reprenne un antidépresseur, car elle lutte trop douloureusement.
Je lui prescris un médicament. Elle repart rassurée comme si elle avait réussi à obtenir ce qu’elle voulait.
Je me sens plutôt défait, et ai l’impression d’avoir perdu la partie. Encore une fois, j’avais cru pouvoir sauver cette femme vraiment sympathique et attachante du cycle infernal et répétitif de sa « maladie », et puis voilà!
Or deuxième grande surprise! A la séance suivante, elle me dit qu’elle a beaucoup réfléchi, et elle s’est dit « c’est trop bête, si je veux vraiment m’en sortir, il ne faut pas que je réagisse comme ça, si je reprends encore un médicament, alors là c’est foutu… »
Je m’empresse de lui faire part de mon étonnement et de la profonde inquiétude qui était la mienne quant à ses idées noires.
« J’espère lui dis-je que vous n’avez pas surestimé vos forces à continuer sans ce médicament ».
Troisième surprise!
Suite à un différent avec l’une de ses filles qui lui refuse de lui confier son fils, Odile va réunir ses enfants pour savoir ce qu’ils pensent d’elle. Elle va apprendre que cette fille ne lui fait pas confiance et n’en peut plus d’entendre quotidiennement le récit des angoisses et des idées noires de sa mère. Les autres lui révèlent qu’ils s’adaptent tant bien que mal à sa maladie, ils n’y peuvent rien, s’en accommodent. Odile confrontera ensuite ces informations avec des amis qui lui disent qu’elle se plaint beaucoup en effet.
Ainsi Odile a non seulement arrêté ses antidépresseurs, mais a commencé à agir sur ses tentatives de solution dans le système de relation (se plaindre, se faire rassurer), et commence à redéfinir une relation de confiance avec ses enfants. Elle produit des changements systémiques.
Enfin elle va aussi réussir à dire non à son ex-mari alcoolique avec lequel elle entretient une relation très insatisfaisante, tantôt par pitié, tantôt pour échapper à la solitude.
Je me rends compte que cette femme très surprenante vu son parcours, est capable, à chaque fois que je baisse les bras (en reconnaissant mon incompétence), ou que je freine, de développer des solutions.
Avec Odile, en définissant mieux le problème, et en sachant prendre une position plus basse au moment où elle m’interpellait dans ma position psychiatrique (« sauvez-moi, ne me laissez pas comme ça »), j’observe que des changements substantiels dans son quotidien et dans ses relations ont été possibles.
Je n’ai à la fois pas renoncé à mon cadre de thérapeute, et je suis resté psychiatre prescripteur possible, mais finalement c’est elle qui décide.
Aujourd’hui Odile semble plus heureuse, elle s’affirme beaucoup plus, elle n’est plus angoissée dans la journée, mais garde des angoisses le matin parfois. En tout cas elle n’en a plus peur. Je lui ai fortement conseillé de ne pas chercher à les éradiquer et d’en garder un peu….
Est-elle bipolaire? Finalement ce n’est pas le problème.
Ces observations et réflexions à partir de ma pratique et de questionnements personnels au fil de mon parcours m’amènent à essayer de tirer quelques conclusions ouvertes. Certaines de ces conclusions sont des évidences, si l’on travaille avec le modèle, mais je me rends compte combien il est facile de les oublier.
En premier lieu pour tendre vers cette position basse aidante, basse paradoxale, sans doute faut-il savoir revenir aux prémisses et cadre du modèle, quant à la définition du problème avec le patient, son objectif et sa vision du monde, ses valeurs. La position basse est certes une position que l’on cherche à garder en tant qu’outil inhérent au modèle, mais on ne peut la conserver sans être attentif aux autres points cardinaux.
Par ailleurs s’aider de groupe de supervision ou d’intervision permet de contrôler et d’éviter certains des écueils décrits et d’autres, et permet d’ajuster la stratégie thérapeutique au plus près des objectifs du patient.
Quant à la question de la prescription de traitements, cela devient un faux problème pourvu que l’on évalue en quoi elle constitue une tentative de solution ou renforce le sens des tentatives de solution.
Si un patient n’a pas d’attente de psychothérapie, et s’il pense que le traitement est le mieux à même de répondre à cette souffrance, alors il n’y a pas lieu de le contredire. S’adresse-t-il au psychiatre ou au psychothérapeute?
En tant que psychiatre je peux choisir de proposer aux gens ce qui me paraît être de l’ordre de mes compétences.
Si je ne souhaite faire que de la thérapie, je dois l’assumer et savoir refuser une demande de prescription. Dans ce cas, la personne peut faire appel à un autre médecin pour le traitement et choisir ou non d’engager une thérapie avec moi.
Si j’accepte de prescrire, alors il me faut être capable d’avoir une stratégie thérapeutique qui puisse lui permettre de faire les expériences paradoxales de changement en allant à l’encontre de ses tentatives de solution, et secondairement de lui permettre d’évaluer si le traitement lui est toujours utile.
Il me semble utile d’observer nos récurrences de fonctionnement personnel et comment l’on peut glisser aisément de bonnes intentions au sentiment de détenir la vérité, plutôt que de maintenir une visée constructiviste de cette réalité avec le patient. Le risque est donc dans ce cas de chercher à imposer sa propre construction de solutions.
Enfin en allant au-delà de la position basse en tant que technique, il m’apparaît utile, et Irène Bouaziz et Chantal Gaudin ont beaucoup communiqué dans ce sens, d’interroger notre prétention à aider les gens et les buts, conscients ou inconscients que nous poursuivons.
Faire confiance aux ressources du patient implique d’abandonner les certitudes et convictions préétablies sur ce que serait une bonne résolution de problème. Je citerai Irène Bouaziz dans une communication sur le lâcher-prise: « Accepter la demande de soulagement en ne préjugeant pas de la forme que celui-ci peut prendre, accepter l’idée que le patient aille mieux avec son problème autant que sans lui ou avec un autre problème. »
Nous pouvons aussi être tiraillés entre la loyauté à notre mandat social, associé à notre statut, et la loyauté à nos idéaux personnels anti- …
Il me semble que cette question est plus aigue lorsque l’on se confronte à la folie, ou la psychose sous diverses formes. Du fait de leur comportement, ces patients mobilisent plus les solutions adaptatives, les solutions aliénantes, de la société. Le psychiatre est donc plus directement exposé, et confronté à des choix inconfortables en fonction de son empathie et de ses identifications avec les comportements du patient, ou encore de ses convictions personnelles.
Les écueils rencontrés avec certains patients comme Paul, personnes qui mobilisent le plus notre égo, notre empathie, notre compassion, – voire la séduction – justifient à mon sens la nécessité de tendre vers une position non seulement basse mais de non-savoir, de dépouillement et d’ouverture, ou encore de lâcher prise, de non-vouloir.
La position basse se travaille dans le champ technique et par le travail personnel pour rester dans le modèle.
La position de non-savoir me semble appeler à un travail sur soi, sur la représentation de l’autre, et de la confiance en ses ressources. Nous sommes peut-être plus des guides, aptes à proposer des expériences de découverte que des éclaireurs de conscience.
Il s’agit dans la relation thérapeutique d’augmenter sa disponibilité à l’autre, en nettoyant ses préjugés personnels envers le patient mais aussi sur le monde dont nous sommes codépendants.
Pour les psychiatres en particulier il est utile de conscientiser la contrainte indirecte dans laquelle on travaille (le mandat) pour pouvoir se recentrer sur les objectifs thérapeutiques du sujet et faire avec cette « contrainte » sans contraindre le patient.
Les moyens de ce travail sur soi peuvent faire appel à des références diverses, philosophies orientales (zen, tao), ou même occidentales (Wittgenstein, Socrate ?), pour certains à la psychanalyse, en tant qu’expérience fantasmatique du rapport à l’autre, voire tout simplement comme j’entendais François Roustang le citer, le tir à l’arc.
En quelque sorte, je viens de l’antipsychiatrie, j’ai un mandat social, je choisis le modèle de Palo Alto comme référence car il m’offre le moyen, au contraire du modèle antipsychiatrique, de rejoindre mes positions anti-aliénantes. Il n’est ni adaptatif, ni référé à une norme psychodynamique, ni dépendant d’un système ou d’une idéologie sociale. Ce modèle permet aux gens de trouver des solutions à leur problème dans le sens de leur objectif. Qu’ils soient « malades » psychiatrique ou non, que l’on pense que la déficience organique existe ou non n’est pas le problème. Enfin, il n’est pas idéalisant du thérapeute, comme peut l’être la psychanalyse, dans laquelle c’est presque inhérent au modèle (transfert, longueur du processus).
Pour terminer je reprendrai une citation de François Roustang:
« Le changement de la relation à soi, aux autres et à l’environnement est en proportion inverse de la volonté de changement. »
© F. Paumier/Paradoxes