Communication à la XIVème journée de Rencontre de Paradoxes, le 17 octobre 2015
Héloïse BERTRAND, orthophoniste, thérapeute
Le modèle de Palo Alto est si parfaitement contre intuitif, du fait de sa vision systémique, constructiviste et de sa stratégie paradoxale que nous pouvons nous demander s’il impose de ce fait une pédagogie particulière. Il s’agira ici de se pencher sur l’apprentissage du modèle de Palo Alto d’un triple point de vue : celui de l’apprenti, celui de l’enseignant et celui, à l’interface, d’étudiant-chercheur.
Nous détaillerons les difficultés rencontrées de part et d’autre, réfléchirons sur leurs origines et sur des moyens de les surmonter. Nous nous fonderons pour ce faire sur notre expérience professionnelle dans le domaine des troubles des apprentissages, ainsi que sur l’observation, une année durant, de l’enseignement et de sa réception à l’École du Paradoxe
——-
Introduction
 « Votre mission, si vous l’acceptez : apprendre le modèle de Palo-Alto ».
« Votre mission, si vous l’acceptez : apprendre le modèle de Palo-Alto ».
Quelques définitions préliminaires : « apprendre » sera pris dans sa double acception, l’action de l’étudiant qui engrange des connaissances et celle de l’enseignant qui instruit son élève, et « modèle de Palo Alto » sera entendu comme la version qu’en propose l’école du Paradoxe où j’ai la chance, depuis près d’un an, d’occuper la place enviable « d’étudiante chercheuse ». Sous cette casquette, j’assiste aux formations du cycle perfectionnement sans participer aux exercices ni aux débats, prenant en note mes « illuminations », mes questions, et des remarques quant à la réception du message pédagogique.
Au cours des séances de formation, l’étudiant-chercheur est à la fois en train d’étudier, en train de s’observer étudiant, et en train d’observer comment les autres étudient et comment les enseignants enseignent. Dans cette position à l’interface entre les apprentis et les enseignants, j’ai été amenée à constater les difficultés émergeant de part et d’autre.
Comme orthophoniste dont les troubles d’apprentissage sont le pain quotidien, la question ne pouvait que m’intéresser.
Ces difficultés d’apprentissage seront explorées d’un côté comme de l’autre, d’abord du point de vue de l’apprenant, de l’apprenti paradoxien, ensuite de celui de l’enseignant en paradoxes.
Du point de vue de l’apprenant :
troubles des apprentissages des apprentis paradoxiens

Désapprendre à être un « bon professionnel »
 Un apprenti paradoxien n’arrive jamais complètement vierge à ce type d’enseignement ; C’est que la formation à l’intervention systémique paradoxale n’est pas une formation initiale. Pour y être admis, il doit exercer une activité professionnelle dans laquelle il pourra utiliser la méthode. Ainsi, même les plus jeunes d’entre eux, ont connu une « vie d’avant » : études de psychologie, métier dans la relation d’aide, formation au coaching, expérience des RH… Au fil de la formation, du fait des particularités du modèle, ils sont amenés à désapprendre tout ce qui faisait selon eux (et pour le commun des mortels) un bon professionnel.
Un apprenti paradoxien n’arrive jamais complètement vierge à ce type d’enseignement ; C’est que la formation à l’intervention systémique paradoxale n’est pas une formation initiale. Pour y être admis, il doit exercer une activité professionnelle dans laquelle il pourra utiliser la méthode. Ainsi, même les plus jeunes d’entre eux, ont connu une « vie d’avant » : études de psychologie, métier dans la relation d’aide, formation au coaching, expérience des RH… Au fil de la formation, du fait des particularités du modèle, ils sont amenés à désapprendre tout ce qui faisait selon eux (et pour le commun des mortels) un bon professionnel.
Un bon professionnel fait des diagnostics
 Ceux qui pratiquent un métier ayant trait de près ou de loin à la « psy » (psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psycho praticien), pensent d’ordinaire qu’il existe une frontière nette entre les patients et les soignants. Or le modèle de Palo Alto propose une approche « non-pathologisante » : que faire désormais de cet entraînement au diagnostic, à la catégorisation ? Il en résulte que les « patients» deviennent des « clients ». Cette vision « non pathologisante » est difficile à admettre sur le coup, mais une fois qu’elle a été métabolisée à grand peine par l’apprenti, il lui faut la tenir face au vaste monde.
Ceux qui pratiquent un métier ayant trait de près ou de loin à la « psy » (psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psycho praticien), pensent d’ordinaire qu’il existe une frontière nette entre les patients et les soignants. Or le modèle de Palo Alto propose une approche « non-pathologisante » : que faire désormais de cet entraînement au diagnostic, à la catégorisation ? Il en résulte que les « patients» deviennent des « clients ». Cette vision « non pathologisante » est difficile à admettre sur le coup, mais une fois qu’elle a été métabolisée à grand peine par l’apprenti, il lui faut la tenir face au vaste monde.
Quant aux coaches, aux RH, aux formateurs et autres professionnels se formant au modèle, s’ils n’ont pas été dressés au diagnostic, ils n’en avaient pas moins une idée de ce qu’était la norme. D’où ces moments où ils estiment que ce n’est pas de leur ressort et que leur interlocuteur devrait aller consulter un psy-quelque chose. Mais le modèle de Palo Alto, non normatif par nature, fait voler cette norme en éclats.
Ainsi ce coach qui, en supervision, amène la situation d’une de ses clientes. Celle-ci suit avec lui un coaching destiné à l’aider à reprendre une vie professionnelle. Or au fil de l’entretien, il apprend qu’elle remplit la maison d’objets qu’elle entasse en d’innombrables collections, que ses aventures sentimentales lui prennent trop de temps pour qu’elle puisse se consacrer à une recherche d’emploi… De plus, elle parle trop fort, trop vite, trop abondamment… si bien que le coach en vient à penser que la situation le dépasse, que sa cliente relève davantage de la psychiatrie que du coaching. La formatrice met de côté ces « particularités » pour recentrer le coach sur le positionnement de sa cliente, et sur les éventuels freinages à mettre en place si elle pense que la situation peut changer.
L’apprenti paradoxien désapprend certes ce qui faisait de lui un « bon professionnel », et c’est difficile. Mais une des conséquences de ces prémisses non-pathologisantes, c’est que l’intervenant, au rebours de nombreuses approches, n’a pas à se demander si lui-même est assez sain pour pratiquer la relation d’aide. Cette abolition de la frontière entre le normal et le pathologique implique qu’il n’est pas nécessaire de suivre une thérapie personnelle pour être un bon intervenant en relation d’aide, d’avoir « nettoyé » tout ce qui devait l’être.
 Un bon professionnel comprend vite et bien ses clients, à demi-mot
Un bon professionnel comprend vite et bien ses clients, à demi-mot
Le bon sens conduit à penser qu’un bon professionnel est celui qui comprend son client à demi-mot. Sa pénétration psychologique et son efficacité sont telles qu’il sait tout de suite à qui il a à faire et de quoi il souffre. Or le modèle de Palo Alto nous apprend à questionner le client sur ce qui pourrait paraître évident, quitte à passer pour un mal comprenant. C’est le fameux « questionnement d’anthropologue ».
Un bon professionnel cherche des causes aux problèmes et les résout ainsi

Certains d’entre les apprentis-paradoxiens ont bu la psychanalyse à la mamelle : ils l’ont étudiée, se sont allongés sur le divan, certains même l’ont pratiquée. Mais les autres, tel monsieur Jourdain faisant de la prose sans le savoir, sont profondément imprégnés de psychanalyse, tant cette façon de voir le monde est intégrée dans les mœurs en France. Impossible d’y échapper, même dans un magazine féminin chez le coiffeur ou dans les conversations autour d’un bac à sable (ou d’un demi de bière). Ainsi, le réflexe naturel, quand on est confronté à un problème, est de savoir d’où il vient, en considérant que la découverte de cette cause résoudra le problème. Cette recherche des origines du problème conduit souvent à la décontextualisation, grande peau de banane à éviter quand on pratique une approche systémique.
Une stagiaire, cliente lors d’une session de formation, soumet au groupe le problème suivant : « J’ai de mauvaises relations avec ma mère, je redoute d’avoir à passer les prochaines semaines avec elle ». L’exercice consiste en un questionnement multi-têtes où chaque stagiaire pose une question à son tour. Au bout du premier tour la formatrice arrête : les stagiaires ont massivement décontextualisé ; ils ont si bien questionné la cliente sur les autres relations problématiques qu’elle entretenait avec d’autres membres de sa famille qu’elle est convaincue d’être nulle, que son problème est énorme et qu’il ne se règlera jamais. La formatrice termine la séance en contextualisant à l’extrême : au fils des questions et des recadrages, l’objectif se trouve réduit sur la conduite la plus confortable à tenir durant ces quelques jours de vacances, non sur une profonde restructuration des liens mère-fille sur plusieurs générations.
Un bon professionnel détient un savoir
 Les apprentis paradoxiens qui ont exercé un métier pendant plusieurs années avaient été amenés à considérer qu’ils pouvaient légitimement se positionner en « professionnel qui sait » ; ils avaient appris à inspirer la confiance par leur assurance. A ceux qui terminaient leurs études, on avait appris à simuler. Or quand on se fonde sur des prémisses constructivistes, on considère que chacun se construit sa représentation de la réalité. Celle de l’intervenant n’est donc pas plus vraie que celle de son client. L’intervenant n’est donc plus celui qui sait mais celui qui ne sait pas, en tout cas qui ne sait pas mieux que son client… Cette attitude de « non-savoir » est d’autant plus risquée à adopter pour l’apprenti quand il est effectivement convaincu de sa grande indignité.
Les apprentis paradoxiens qui ont exercé un métier pendant plusieurs années avaient été amenés à considérer qu’ils pouvaient légitimement se positionner en « professionnel qui sait » ; ils avaient appris à inspirer la confiance par leur assurance. A ceux qui terminaient leurs études, on avait appris à simuler. Or quand on se fonde sur des prémisses constructivistes, on considère que chacun se construit sa représentation de la réalité. Celle de l’intervenant n’est donc pas plus vraie que celle de son client. L’intervenant n’est donc plus celui qui sait mais celui qui ne sait pas, en tout cas qui ne sait pas mieux que son client… Cette attitude de « non-savoir » est d’autant plus risquée à adopter pour l’apprenti quand il est effectivement convaincu de sa grande indignité.
Un bon professionnel veut « quelque chose » pour son client
 Comme professionnel de la relation humaine, il semble évident de vouloir le bien de la personne dont on s’occupe, à quelque titre que ce soit. Cependant, si les paradoxiens, comme les autres, veulent le bien de leur client, ils ne lui veulent pas un bien spécifique. Ils s’astreignent à ne pas juger en fonction de leurs critères ou de critères normatifs de bonheur ou de réussite ; Ils ne poussent pas leur client à acquérir une Rolex avant l’âge de 50 ans, à « se trouver un mec », à changer de boulot. Ils adoptent ainsi une attitude de « non-vouloir », laissant leur client trouver ce qui est le mieux pour lui.
Comme professionnel de la relation humaine, il semble évident de vouloir le bien de la personne dont on s’occupe, à quelque titre que ce soit. Cependant, si les paradoxiens, comme les autres, veulent le bien de leur client, ils ne lui veulent pas un bien spécifique. Ils s’astreignent à ne pas juger en fonction de leurs critères ou de critères normatifs de bonheur ou de réussite ; Ils ne poussent pas leur client à acquérir une Rolex avant l’âge de 50 ans, à « se trouver un mec », à changer de boulot. Ils adoptent ainsi une attitude de « non-vouloir », laissant leur client trouver ce qui est le mieux pour lui.
Cette posture de non-vouloir demande une vraie souplesse : comment ne pas vouloir qu’une femme battue quitte son horrible bonhomme ? Comment ne pas vouloir qu’un jeune homme vierge de 39 ans connaisse enfin l’amour ? Que cette femme parvienne à arrêter de boire ? que ce jeune cadre prometteur prenne de l’assurance ? que ce manager qui ne communique que par emails accepte enfin de sortir de son bureau ?
Un bon pro donne des solutions, des conseils
Nomb reux sont les apprentis paradoxiens à avoir, dans leur vie antérieure, donné des conseils : qu’ils exercent directement le métier de « consultant » ou que le titre même de leur profession affiche la couleur (orthophoniste, au hasard). Ils estiment qu’on attend d’eux une position d’expert qui donnera des directions à suivre.
reux sont les apprentis paradoxiens à avoir, dans leur vie antérieure, donné des conseils : qu’ils exercent directement le métier de « consultant » ou que le titre même de leur profession affiche la couleur (orthophoniste, au hasard). Ils estiment qu’on attend d’eux une position d’expert qui donnera des directions à suivre.
Or dans l’approche de Palo Alto, il s’agit de rejoindre le client dans sa vision du monde, et l’amener à arrêter de faire ce qui ne marche pas pour résoudre son problème. Mais quand le client en trouve une, quand il est bien apaisé et très satisfait de sa séance, l’intervenant paradoxien s’empresse de freiner : « c’est une idée parmi d’autres/ ça peut marcher… ou pas ». Ainsi le client reste libre, il n’est pas figé dans une nouvelle vision du monde. 10’
Désapprendre les réflexes d’être humain
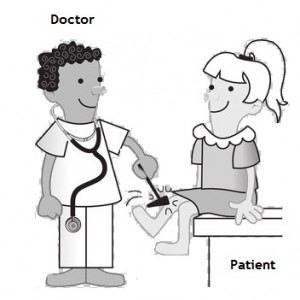 Une fois qu’il a bien désappris à être ce qu’il avait été amené à considérer un « bon professionnel », l’apprenti paradoxien doit se départir de ses réflexes les plus naturels d’être humain.
Une fois qu’il a bien désappris à être ce qu’il avait été amené à considérer un « bon professionnel », l’apprenti paradoxien doit se départir de ses réflexes les plus naturels d’être humain.
Se décaler de l’émotion de son interlocuteur
L’intervenant doit garder en toutes circonstances sa position « méta » ; il doit donc veiller à gérer ses réflexes de « sympathie » au sens propre du terme. Il s’agit de garder secs son œil systémique et son œil stratégique en toutes circonstances. Ainsi, je soumets en supervision le cas d’un petit garçon dont je m’occupe. A chaque début de séance, sa mère me décrit les terribles phobies dont il souffre : il « voit » des monstres par terre avec un tel réalisme qu’il hurle à l’idée de descendre de sa chaise ; sa mère, ne pouvant le porter, le garçon doit attendre le retour de son père perché sur sa chaise. Il est persuadé que des monstres le guettent dans les couloirs et ne peut quitter sa mère d’une semelle… entre autres. Seule avec l’enfant, je tente en vain, séance après séance de lui faire parler de ses peurs. Or il demande à jouer, à peindre, à dessiner, sans jamais que le sujet des peurs n’affleure. Je me représente ce que vit ce petit garçon enchaîné à sa chaise et terrifié dans sa propre maison et me ronge de ne pouvoir l’aider davantage. Il s’agit justement de ne pas se laisser déborder par ce flot d’angoisse mais de chercher, comme dans d’autres situations, qui demande à qui quoi, de savoir précisément ce qui pose problème aux parents dans le comportement de leur enfant, ce qu’ils pensent traitable, comment ils expliquent ce qui se passe, ce qu’ils font face aux comportements problématiques…
garder en toutes circonstances sa position « méta » ; il doit donc veiller à gérer ses réflexes de « sympathie » au sens propre du terme. Il s’agit de garder secs son œil systémique et son œil stratégique en toutes circonstances. Ainsi, je soumets en supervision le cas d’un petit garçon dont je m’occupe. A chaque début de séance, sa mère me décrit les terribles phobies dont il souffre : il « voit » des monstres par terre avec un tel réalisme qu’il hurle à l’idée de descendre de sa chaise ; sa mère, ne pouvant le porter, le garçon doit attendre le retour de son père perché sur sa chaise. Il est persuadé que des monstres le guettent dans les couloirs et ne peut quitter sa mère d’une semelle… entre autres. Seule avec l’enfant, je tente en vain, séance après séance de lui faire parler de ses peurs. Or il demande à jouer, à peindre, à dessiner, sans jamais que le sujet des peurs n’affleure. Je me représente ce que vit ce petit garçon enchaîné à sa chaise et terrifié dans sa propre maison et me ronge de ne pouvoir l’aider davantage. Il s’agit justement de ne pas se laisser déborder par ce flot d’angoisse mais de chercher, comme dans d’autres situations, qui demande à qui quoi, de savoir précisément ce qui pose problème aux parents dans le comportement de leur enfant, ce qu’ils pensent traitable, comment ils expliquent ce qui se passe, ce qu’ils font face aux comportements problématiques…
Contrôler son non-verbal
 S’accorder intuitivement au registre émotionnel de la personne qu’on a en face de soi est presque un réflexe : sourire quand elle sourit, prendre une mine affligée quand elle rapporte une histoire dramatique… Or, dans une stratégie à contre-sens, le paradoxe doit tenir jusque dans le non-verbal. Il est parfois très recadrant pour le client que l’intervenant garde un visage neutre quand il rapporte des faits horribles, ou au contraire que l’intervenant écarquille les yeux à l’écoute de récits présentés comme anodins. Il est donc très important de contrôler son non-verbal, en se retenant par exemple d’opiner à tout bout de champ : car en acquiesçant, même a minima, d’un hochement de tête ou d’un sourire entendu, l’intervenant risquerait de verrouiller la vision du monde que lui propose le client, rendant tout recadrage bien plus difficile à introduire.
S’accorder intuitivement au registre émotionnel de la personne qu’on a en face de soi est presque un réflexe : sourire quand elle sourit, prendre une mine affligée quand elle rapporte une histoire dramatique… Or, dans une stratégie à contre-sens, le paradoxe doit tenir jusque dans le non-verbal. Il est parfois très recadrant pour le client que l’intervenant garde un visage neutre quand il rapporte des faits horribles, ou au contraire que l’intervenant écarquille les yeux à l’écoute de récits présentés comme anodins. Il est donc très important de contrôler son non-verbal, en se retenant par exemple d’opiner à tout bout de champ : car en acquiesçant, même a minima, d’un hochement de tête ou d’un sourire entendu, l’intervenant risquerait de verrouiller la vision du monde que lui propose le client, rendant tout recadrage bien plus difficile à introduire.
Réprimer sa curiosité… tout en l’aiguisant
 L’apprenti paradoxien doit désapprendre la curiosité, ou plutôt apprendre à écarter sa curiosité anecdotique tout en développant sa curiosité stratégique. Ecarter sa curiosité anecdotique, car toute question est riche en implicites. Ainsi, j’ai reçu un jeune garçon pour troubles du comportement. Au téléphone, sa mère m’explique qu’il est si violent qu’il est souvent exclu de l’école. Il vient au rendez-vous accompagné de sa mère et de sa grand-mère. Durant tout l’entretien, pendant que la mère et la grand-mère détaillent les difficultés éducatives qu’elles rencontrent avec le jeune garçon au quotidien, je me demande s’il y a un papa dans l’histoire. Je me discipline pour ne pas poser cette question parce qu’à aucun moment la cliente ne me parle du père de l’enfant. Elle ne considère donc pas que ce soit un élément susceptible d’éclairer la situation. Si donc je pose cette question, l’implicite est que je considère que la présence ou l’absence du père a un lien avec les difficultés comportementales du fils, par exemple que la situation est ainsi faute de la présence d’une autorité mâle à domicile.
L’apprenti paradoxien doit désapprendre la curiosité, ou plutôt apprendre à écarter sa curiosité anecdotique tout en développant sa curiosité stratégique. Ecarter sa curiosité anecdotique, car toute question est riche en implicites. Ainsi, j’ai reçu un jeune garçon pour troubles du comportement. Au téléphone, sa mère m’explique qu’il est si violent qu’il est souvent exclu de l’école. Il vient au rendez-vous accompagné de sa mère et de sa grand-mère. Durant tout l’entretien, pendant que la mère et la grand-mère détaillent les difficultés éducatives qu’elles rencontrent avec le jeune garçon au quotidien, je me demande s’il y a un papa dans l’histoire. Je me discipline pour ne pas poser cette question parce qu’à aucun moment la cliente ne me parle du père de l’enfant. Elle ne considère donc pas que ce soit un élément susceptible d’éclairer la situation. Si donc je pose cette question, l’implicite est que je considère que la présence ou l’absence du père a un lien avec les difficultés comportementales du fils, par exemple que la situation est ainsi faute de la présence d’une autorité mâle à domicile.
Il ne faut pas non plus tomber dans le « piège systémique », c’est-à-dire multiplier les questions avec l’illusion que plus on en sait, mieux c’est. Le questionnement est dit « stratégique » car il a la double fonction d’éclairer intervenant et client, et d’agir dans le sens de la stratégie. Il s’agit de développer une curiosité sur la situation problématique : (qu’est-ce que la « dépression », la « peur », « trop » ou « pas assez » pour vous ?) au lieu de coller une étiquette sur le problème sans chercher assez à comprendre ce qu’elle recouvre. La posture de l’anthropologue, celui qui questionne sur ce qui semble aller de soi, ne pousse pas à poser des questions tous azimuts mais à manifester de la curiosité pour tout ce qui a trait à la vision du monde sur le problème.
Ne pas rassurer
 Le premier réflexe d’un être humain face à un autre qui souffre est de le rassurer : « mais non tu n’es pas nul ! Mais non tu n’es pas moche ! » Cela a souvent pour effet que l’être humain en question, loin de se laisser rassurer, se lance dans une vigoureuse démonstration de son indignité ou de sa laideur. Toutefois, c’est irrésistible.
Le premier réflexe d’un être humain face à un autre qui souffre est de le rassurer : « mais non tu n’es pas nul ! Mais non tu n’es pas moche ! » Cela a souvent pour effet que l’être humain en question, loin de se laisser rassurer, se lance dans une vigoureuse démonstration de son indignité ou de sa laideur. Toutefois, c’est irrésistible.
Ainsi, lors d’une session de formation, l’une des stagiaires se propose comme cliente. Professionnelle expérimentée, elle expose une situation dans laquelle elle estime avoir manqué de lucidité ; Le premier mouvement qui vient à l’esprit est de la rassurer, de la réconforter par d’ingénieux recadrages « Si tu n’as rien vu, c’est qu’il était impossible de voir quoi que ce soit… tu n’étais pas seule dans cette intervention, ton collègue non plus n’a rien vu ! ». Or ce premier mouvement (naturel) de réassurance revient implicitement à dire « tu as tort de penser que tu as manqué de lucidité »… (« donc tu es encore moins lucide que tu le pensais »). Il ne s’agit pas dès lors de l’inquiéter davantage en lui disant explicitement qu’elle a fait une erreur, mais d’explorer ce qui est une erreur de son point de vue.
Se garder d’être positif
Dans la même veine, l’apprenti paradoxien doit se garder de la propension toute naturelle quand on veut aider quelqu’un à vouloir lui faire envisager la situation sous un jour positif, dans le courant « mais non, mais non, ça va aller ! » En effet, une telle attitude a pour implicite dévalorisant que le client a tort de s’inquiéter en pareilles circonstances.
Ainsi, face à un client qui n’a plus que 18 mois pour décider de sa réorientation professionnelle, un paradoxien accompli répondra « donc presque plus de temps », au lieu d’un réconfortant « vous avez encore un an et demi ! ». Le modèle de Palo Alto propose souvent le « scénario du pire », parfois même à des moments où la séance se termine et où le patient partirait presque rassuré et content.
Renoncer à ses convictions
S’il est difficile de renoncer à l’idée d’une norme dans l’exercice de sa profession, c’est que tout être humain normal a des convictions, tout constructiviste qu’il se veuille.
de renoncer à l’idée d’une norme dans l’exercice de sa profession, c’est que tout être humain normal a des convictions, tout constructiviste qu’il se veuille.
Quand on est parent soi-même, on s’est fait nécessairement une idée de la façon « correcte » d’éduquer ses enfants. Il est bien difficile de s’en départir : cette mère m’amène sa fille de 8 ans pour des difficultés d’acquisition de la lecture; elle m’apprend qu’elle nourrit sa fille de biberons et de sucreries, lui fait porter une couche, la laisse se traîner par terre dans les flaques si elle le souhaite… Il s’agit alors, si on est constructiviste, de ne considérer ces particularités que comme des éléments de contexte et de se discipliner à explorer la situation en cherchant à savoir s’il y a un problème et un objectif.
Apprendre des notions trop difficiles… ou trop faciles ?
Je viens de détailler, parmi les raisons qui rendent le modèle de Palo Alto difficile à acquérir, celles qui ont trait à son côté contre-intuitif, pour le professionnel comme pour l’être humain tout court.
Une autre raison réside dans la difficulté intrinsèque de certaines notions abordées.
La logique du paradoxe
… est d’un premier abord pour le moins ardue. D’abord sa théorie fait référence à la théorie mathématique complexe des types logiques. Ensuite sa mise en pratique va à contre-sens du sens commun si bien qu’il est bien difficile à l’apprenti-paradoxien, brindille à la surface, de rester à contre-courant.
Le regard systémique
 en tant que tel froisse notre pensée cartésienne convaincue que diviser permet de mieux comprendre. Il implique en outre un constant va-et-vient. Le regard systémique impose de savoir être attentif au détail, sans perdre de vue la globalité. Cela ressemble à un artiste peignant un fresque immense : il doit sans cesse se reculer pour ne pas perdre de vue la globalité du tableau mais aussi évidemment être tout près pour pouvoir peindre les détails.
en tant que tel froisse notre pensée cartésienne convaincue que diviser permet de mieux comprendre. Il implique en outre un constant va-et-vient. Le regard systémique impose de savoir être attentif au détail, sans perdre de vue la globalité. Cela ressemble à un artiste peignant un fresque immense : il doit sans cesse se reculer pour ne pas perdre de vue la globalité du tableau mais aussi évidemment être tout près pour pouvoir peindre les détails.
Mais le plus difficile dans le regard systémique, c’est de regarder ce qui ne se voit pas, c’est à dire les messages échangés, ce qui est dit et ce qui est répondu, alors que nous sommes culturellement entraînés à regarder plutôt les individus, voire à explorer leur intérieur.
L’attention portée aux implicites
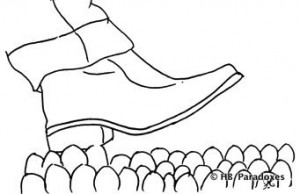 L’apprenti paradoxien doit se rendre sensible aux implicites des messages qu’il envoie et apprendre à les contrôler. Pour le débutant, cette attention peut donner l’impression d’avancer en terrain miné, comme si sous chaque phrase innocente, sous chaque question fortuite, voire dans chaque geste ou mimique se tapissait toujours une armée d’affreux implicites atrocement dévalorisants.
L’apprenti paradoxien doit se rendre sensible aux implicites des messages qu’il envoie et apprendre à les contrôler. Pour le débutant, cette attention peut donner l’impression d’avancer en terrain miné, comme si sous chaque phrase innocente, sous chaque question fortuite, voire dans chaque geste ou mimique se tapissait toujours une armée d’affreux implicites atrocement dévalorisants.
Ainsi, lors d’un bilan orthophonique pour évaluer un trouble du langage, demander si d’autres langues sont parlées à la maison peut avoir comme implicite : « c’est parce que le français n’est pas votre langue maternelle que votre enfant a des difficultés pour parler ». De même, le simple fait de sortir son carnet de rendez-vous à la fin d’une séance peut avoir comme implicite que l’on considère que le client a besoin de revenir.
Au vu de toutes ces difficultés, il semble à l’apprenti paradoxien qu’il lui faudrait réunir un sens aigu de la logique, un talent pour la rhétorique, une mémoire phénoménale, être tout à la fois normalien, polytechnicien, et contorsionniste. Nouvelle erreur de sa part car parfois, ce dont il souffrirait serait peut-être un excès d’intelligence. En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est parfois un excès de simplicité qui rend le modèle difficile à acquérir.
La notion de problème
Ainsi, la notion de « problème » : sa définition comme un « comportement insatisfaisant », réduisant la compl exité, déçoit les esprits subtils. En effet, quoi de plus séduisant pour l’esprit qu’un problème bien alambiqué, dont les racines sont à chercher dans les générations d’antan et les manifestations dans toute une kyrielle de situations analogues ? tant il est vrai que la recherche des causes et d’analogies sont des opérations logiques que pratiquent avec bonheur les esprits vifs.
exité, déçoit les esprits subtils. En effet, quoi de plus séduisant pour l’esprit qu’un problème bien alambiqué, dont les racines sont à chercher dans les générations d’antan et les manifestations dans toute une kyrielle de situations analogues ? tant il est vrai que la recherche des causes et d’analogies sont des opérations logiques que pratiquent avec bonheur les esprits vifs.
La définition palo-altienne du problème ne le rend pas pour autant facile à appréhender : protéiforme et changeant, en perpétuelle mutation, il ne cesse, au fil de la séance d’être construit et déconstruit, à la faveur des recadrages.
De la difficulté de comprendre à celle d’appliquer
Une fois maîtrisés les principes de la théorie, un entraînement est toujours nécessaire. Dans une perspective cybernétique, la théorie nourrit la pratique qui nourrit la théorie.
Les artefacts de la méthode
Or quand il est bien entraîné, l’apprenti paradoxien confirmé voit parfois surgir des difficultés qu’il n’aurait jamais imaginées auparavant.
En supervision, il se plaint de n’avoir pas su « faire de paradoxe » avec son client. 
 Ou alors, à rebours, il paradoxe à tout va, bien trop tôt et même s’il n’y a pas de problème, pour le seul plaisir d’utiliser son nouveau jouet. Il semble que ce travers n’épargne pas les plus grands, tant il est vrai que « quand on a un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous ». Inlassablement, il cherche le problème comme un chevalier en quête du graal, au risque d’en créer là où il n’y en a pas.
Ou alors, à rebours, il paradoxe à tout va, bien trop tôt et même s’il n’y a pas de problème, pour le seul plaisir d’utiliser son nouveau jouet. Il semble que ce travers n’épargne pas les plus grands, tant il est vrai que « quand on a un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous ». Inlassablement, il cherche le problème comme un chevalier en quête du graal, au risque d’en créer là où il n’y en a pas.
Un autre de ses nouveaux problèmes est d’avoir peur de « plaquer sa vision du monde » sur son client, ou bien à l’inverse, de vouloir à tout prix convaincre son client qu’il faut être constructiviste.
 Il peut enfin tomber dans l’illusion systémique, ambitionner de faire du bien au système dans son ensemble. Il lui faut avoir présent à l’esprit qu’il s’agit « d’arrêter le message inefficace d’une personne, pas de 10000 ».
Il peut enfin tomber dans l’illusion systémique, ambitionner de faire du bien au système dans son ensemble. Il lui faut avoir présent à l’esprit qu’il s’agit « d’arrêter le message inefficace d’une personne, pas de 10000 ». 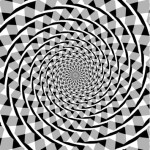
Du point de vue de l’enseignant :
un enseignement impossible ?
Si le modèle de Palo Alto est difficile à acquérir pour l’apprenti paradoxien, il est également difficile à enseigner pour le professeur en paradoxes. En effet, les prémisses même du modèle placent l’enseignant dans une position contradictoire, voire paradoxale.
La première contradiction pourrait être résumée en ces termes :
« Je suis constructiviste mais j’ai raison » :
En effet, il est impossible à la fois de dire que la vérité n’existe pas, que toutes les vérités se valent, et d’enseigner un modèle théorique quel qu’il soit.
Il s’agit alors pour le formateur paradoxien de s’astreindre lui-même à prendre en compte les différents niveaux logiques. Si l’on monte d’un cran, l’idée que tout n’est que construction est elle-même une construction. Si l’on redescend d’un cran, comme aucune construction n’est meilleure qu’une autre, alors rien n’empêche le formateur paradoxien d’enseigner un modèle construit avec l’idée qu’il est lui-même une construction.
Une autre apparente contradiction: « Je te rejoins dans ta vision du monde, mais abandonne-la ! »
 Tout nouvel apprentissage peut être considéré comme un recadrage. Il pousse celui qui le reçoit à restructurer sa vision du monde pour tenir compte de ces nouvelles informations. Certains spécialistes de l’autisme avancent que c’est pour cette raison-là que les personnes autistes ont du mal à apprendre : détestant les surprises et les nouveautés, adorant ce qui est répétitif et prévisible, tout nouvel apprentissage les bouleverse si bien qu’elles auraient tendance à les fuir. L’enseignant paradoxien se trouverait donc dans une situation où, contrairement aux fondements théoriques de ce qu’il enseigne, il forcerait les recadrages et « voudrait quelque chose » pour l’autre : il voudrait qu’il acquière cette nouvelle façon de voir le monde.
Tout nouvel apprentissage peut être considéré comme un recadrage. Il pousse celui qui le reçoit à restructurer sa vision du monde pour tenir compte de ces nouvelles informations. Certains spécialistes de l’autisme avancent que c’est pour cette raison-là que les personnes autistes ont du mal à apprendre : détestant les surprises et les nouveautés, adorant ce qui est répétitif et prévisible, tout nouvel apprentissage les bouleverse si bien qu’elles auraient tendance à les fuir. L’enseignant paradoxien se trouverait donc dans une situation où, contrairement aux fondements théoriques de ce qu’il enseigne, il forcerait les recadrages et « voudrait quelque chose » pour l’autre : il voudrait qu’il acquière cette nouvelle façon de voir le monde.
Toute la subtilité justement d’un enseignement en accord avec l’éthique qu’il défend consiste donc à éviter ce forcing. Conformément aux prémisses constructivistes, il s’agirait de présenter le contenu de l’enseignement comme une façon de voir le monde que les apprentis sont libres d’adopter, ou pas.
La transmission d’un geste contre intuitif
 Quand un élève en chant lyrique prend ses premières leçons, il s’époumone ; le mouvement naturel quand on veut chanter fort est de respirer en gonflant au maximum son torse, et d’expirer le plus puissamment possible. Il incombe alors au professeur la délicate mission de le convaincre de faire le contraire de tout ce qu’il a coutume de faire : retenir le son, ne pas soulever les épaules… Il est probable ce-faisant qu’il soit aphone en peu de temps. Si la théorie du chant n’est pas très compliquée, de très nombreuses années sont nécessaires pour acquérir ce geste vocal si différent de ce qu’on imagine
Quand un élève en chant lyrique prend ses premières leçons, il s’époumone ; le mouvement naturel quand on veut chanter fort est de respirer en gonflant au maximum son torse, et d’expirer le plus puissamment possible. Il incombe alors au professeur la délicate mission de le convaincre de faire le contraire de tout ce qu’il a coutume de faire : retenir le son, ne pas soulever les épaules… Il est probable ce-faisant qu’il soit aphone en peu de temps. Si la théorie du chant n’est pas très compliquée, de très nombreuses années sont nécessaires pour acquérir ce geste vocal si différent de ce qu’on imagine
Il en va de même pour l’apprentissage du modèle de Palo-Alto : il faut enseigner de nouveaux gestes, le regard systémique et constructiviste, la contextualisation, le freinage. Il faut adapter des gestes déjà connus pour les faire aller dans d’autres directions : rester à contre sens même dans son non-verbal, ne pas consoler ou rassurer… La tâche de transmettre ce geste complètement contre-intuitif nécessite de la part de l’enseignant une patience et une endurance à la répétition proches de l’abnégation.
La variété du public
 En outre, comme le modèle de Palo Alto peut s’appliquer dans des contextes très différents, les enseignants paradoxiens sont confrontés à un public pour le moins bigarré : des psys sous toutes leurs formes, des coaches, des DRH, des travailleurs sociaux, des professeurs, des orthophonistes, des urbanistes, et même des « docteurs en série télé ».
En outre, comme le modèle de Palo Alto peut s’appliquer dans des contextes très différents, les enseignants paradoxiens sont confrontés à un public pour le moins bigarré : des psys sous toutes leurs formes, des coaches, des DRH, des travailleurs sociaux, des professeurs, des orthophonistes, des urbanistes, et même des « docteurs en série télé ».
Cette grande variété d’interlocuteurs pousse l’enseignant paradoxien à une constante accommodation. Avant que l’étudiant soit capable de faire lui-même l’analogie entre la situation présentée et ses préoccupations professionnelles, c’est à l’enseignant qu’incombe cette tâche délicate de transposition. Il lui faut donc en permanence parler « le langage du client » : la situation d’une enfant dyslexique qui consulte à la demande de l’école alors que les parents ne voient pas le problème devient une épineuse situation où le n+2 est demandeur mais le n+1 ne l’est pas.
« Ça dépend du contexte »
 Pour finir, le regard systémique conduit à considérer toute difficulté comme inextricablement liée à son contexte. Ainsi tout protocole (ou autre check liste, test systématique…) est en contradiction avec l’essence du modèle de Palo Alto. Or l’enseignement, s’il se veut un tant soit peu théorique, nécessite de pouvoir transmettre quelques invariants. De là les demandes répétées des stagiaires : « comment fait-on dans les cas où… ? que fait-on avec les gens qui… ? et dans les moments où…? et de là l’immuable et frustrante réponse des formatrices : « Ca dépend du contexte ! »
Pour finir, le regard systémique conduit à considérer toute difficulté comme inextricablement liée à son contexte. Ainsi tout protocole (ou autre check liste, test systématique…) est en contradiction avec l’essence du modèle de Palo Alto. Or l’enseignement, s’il se veut un tant soit peu théorique, nécessite de pouvoir transmettre quelques invariants. De là les demandes répétées des stagiaires : « comment fait-on dans les cas où… ? que fait-on avec les gens qui… ? et dans les moments où…? et de là l’immuable et frustrante réponse des formatrices : « Ca dépend du contexte ! »
Il s’agit alors de faire passer une formation rigoureuse, tout en entraînant les apprentis à rester le plus souple possible. Il incombe à l’enseignant en paradoxes d’enseigner un mode de raisonnement, un processus, une stratégie qui restent immuables alors que leur mode d’application est chaque fois différent et les situations auxquels ils s’appliquent varient à l’infini. Mission impossible ?
Conclusion
Travailler sur cette question de la difficulté de l’apprentissage, d’un côté comme de l’autre, a eu l’intérêt de me pousser à formaliser ce qui fait que le modèle de Palo Alto me semblait si difficile à acquérir et à expliquer, dans les cas où des collègues m’interrogent sur cette « nouvelle formation » qui me passionne. Ma position à l’interface m’a permis d’apprécier une véritable « cybernétique de l’enseignement » dans laquelle l’enseignement est constamment modifié au gré des feed-backs.
Cet enseignement pourrait être vu comme une intervention systémique paradoxale en soi. L’enseignement serait donc performatif, il enseignerait par l’exemple tout autant que par les enseignements qu’il véhicule. Dans cette analogie, l’apprenti Palo Altien serait en position de client. Pour ce faire, pour qu’un changement advienne, il devrait être loin de son point d’équilibre, « prêt à bouger », c’est-à-dire suffisamment insatisfait de sa vision du monde pour permettre qu’elle soit bouleversée par un changement aussi radical.
Du côté de l’enseignant, sa place s’assimilerait à celle de l’intervenant : il rejoint son élève dans sa vision du monde, parle son langage, veille à ne pas le heurter, s’adapte constamment, au gré des feed back, à ce que son élève est capable d’entendre à ce moment-là… Cela m’évoque les dialogues de Socrate, tels que Platon les a écrits, ces échanges au cours desquels chacun des interlocuteurs s’influençait l’un l’autre, au terme duquel chacun était changé.
Ainsi, le chemin du paradoxe est bien plus qu’un apprentissage, il est une profonde mutation au cours de laquelle enseignant et enseigné se changent mutuellement, comme professionnels bien sûr, mais aussi comme êtres humains.
Sur ce chemin, on constate souvent que, si l’on n’arrive pas à être « paradoxien », on ne peut plus non plus s’empêcher de l’être.
—
© Héloïse BERTRAND/Paradoxes
Pour citer cet article : Héloïse Bertrand, L’apprentissage du modèle de Palo Alto: Mission impossible ? 2015. www.paradoxes.asso.fr/2015/10/lapprentissage-du-modele-de-palo-alto-mission-impossible







Bonjour Héloïse,
Quelle merveille de te relire après le cycle 1 de cet été !
Merci et bon été à toi.
François B
Merci à vous pour cette publication qui commente de façon très pertinente et inspirée l’esprit de l’intervention systémique paradoxale proposée par l’école du paradoxes.
J’ai aimé votre présentation simple (et non simpliste) et moi, apprenti paradoxien, je lis et relis avec plaisir votre compréhension de cette approche… toute contre-intuitive. Un grand merci à vous !!!